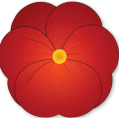Faisant la différence “entre les téméraires qui croient qu’ils savent et les sages qui savent qu’ils croient” le célèbre biologiste expose ce à quoi il croit, même lorsque la raison suprême commanderait de “suspendre le jugement”.
Partant du constat que l’homme est un animal, Jean Rostand nous livre sa vision de l’évolution de la vie et la genèse.
“D’une foule de circonstances – climatiques, biologiques et autres – dépendaient la réussite de l’homme, et si la conjoncture eût été différente, la terre, sans doute eut connu un autre roi [que l’homme].”
Le progrès de la civilisation ne se transmettant pas de manière héréditaire, il met en garde la société qui se doit de le transmettre par l’éducation et l’instruction de génération en génération.
Si comme je le crois, la conscience est liée indissolublement à son substrat matériel, on ne voit guère comment quoi que ce fût de la personnalité spirituelle pourrait survivre à la de l’organe cérébral, et plus généralement de l’édifice corporel. De surcroît, la croyance en l’immortalité du moi soulève chez le biologiste de graves objections en ce qui concerne la genèse du moi. Le philosophe Ribot a pertinemment remarqué que, si les penseurs spiritualistes et les théologiens se sont beaucoup occupés de la destinée future de l’âme, ils se sont, en revanche, assez peu inquiétés de son mode de formation. Pour ma part, je ne puis faire autrement que d’identifier le « moi » psychique avec les propriétés psychiques de l’agrégat cellulaire qui constitué l’individu, propriétés qui elles mêmes découlent de celles qui préexistaient dans le germe et qui dépendaient étroitement de sa constitution génétique. Or cette constitution, elle fut déterminée, dès l’heure de la conception par une double série de hasards : hasards de la réduction chromatique, qui attribua à chaque germe parental tels chromosomes et non tels autres ; hasards de la fécondation, qu fit rencontrer tel germe maternel par tel germe paternel et non par tel autre
[…] Comment se résoudrait on à croire que la propriété de survivance, que le droit à la survie ait soudainement apparu à un certain niveau de l’échelle organique, à un certain stade de l’évolution ? Non, si l’homme est immortel, il faut que le pithécanthrope l’ait été, et que le grand singe le soit, et aussi le petit singe, et le mammifère, et le reptile, et le poisson, et toute la suite de nos ancêtres, jusqu’aux unicellulaires. Il faut que chaque cellule, que chaque microbe, que chaque virus soit doué d’une microsurvie, d’une microimmortalité. Il faut que le dernier des grumeaux de protoplasme qui assimile et se reproduit soit assuré de laisser une trace indélébile de son passage. Il faut qu’éternellement il persiste avec les particularités de sa microexistence, avec son micropassé, avec ses microsouvenirs, avec tout ce qu’il fut ce grumeau de protoplasme et non point cet autre.
Certes nous apparaissons à nos yeux comme seul digne de permanence. Nous avons le sentiment d’être le seul bibelot précieux que contienne l’immense bric-à-brac de la nature, le seul dont il serait dommage qu’on ne pût recoller les miettes après qu’il s’est cassé…Mais de quel droit revendiquerions – nous un tel régime d’exception ? et pouvons nous décemment, sérieusement penser que, dans l’immense et inépuisable nature, nous ayons plus de valeur que n’importe lequel de nos compagnons de vie ? La nature, qui n’est ni bonne ni méchante, ni maternelle ni féroce, nous donne, sur le plan des réalités visibles, le spectacle incessant de l’élimination et du renouvellement. Transitoires, éphémères, toutes ses créations : espèces, genres, familles, classes mêmes, elles les a balayés négligemment au cours des âges.
Comme l’idée d’un Conservatoire des personnes, d’un Musée des individus paraît donc contraire à son génie !
(extraits du livre publié en 1953 chez Grasset)