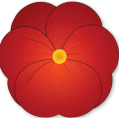Chères auditrices, chers auditeurs, Bonjour. Au micro Christophe Bitaud, vice-Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, j’ai le plaisir de recevoir aujourd’hui Maître Arié Alimi, avocat, membre de la Ligue des Droits de l’Homme et auteur d’un ouvrage intitulé “Le coup d’État d’urgence permanent”.
C.B. : Arié Alimi, Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
A.A. : Bonjour. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis également membre du bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme. Comme vous venez de l’indiquer j’ai sorti il n’y a pas très longtemps un ouvrage qui s’appelle “Le coup d’État d’urgence permanent“.
C.B. : Vous êtes parmi les initiateurs de la mobilisation contre la proposition de loi sur la Sécurité globale. Loi qui a d’ailleurs été votée maintenant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes parmi ces initiateurs ?
A.A. : Tout simplement parce que c’est un texte extrêmement liberticide au même titre d’ailleurs que l’autre texte dit « séparatisme ». C’est un texte qui transforme la sécurité en France mais également nos libertés. D’abord parce qu’il instaure un nouveau paradigme de surveillance généralisée avec la création d’un dispositif de drones qui vont nous surveiller depuis le ciel, y compris dans nos appartements, qui instaure un nouveau système de propagande dans la mesure où il va y avoir ces caméras piétons sur les fonctionnaires de police dont on va pouvoir utiliser les images directement à des fins de communication par l’autorité préfectorale et puis surtout un fameux article 24 dont beaucoup ont parlé et qui a pour vocation d’empêcher les journalistes, les vidéastes amateurs de filmer et diffuser les images de fonctionnaires de police notamment dans le cadre du maintien de l’ordre ou lorsqu’il y a des violences policières. Comme c’est un domaine qui me tient à cœur car je défends depuis très longtemps des victimes de violences policières et que j’essaye de défendre les libertés publiques avec la LDH, c’est la raison pour laquelle on a initié, avec la coordination, ce mouvement social.
C.B. : Ce fameux article dont on a effectivement beaucoup parlé fait peser de graves menaces sur le métier de journaliste et sur les libertés ?
A.A. : Demain on ne pourra plus être journaliste comme on l’était hier avec ce texte qui vient d’être voté par le Sénat et ratifié par la Commission mixte paritaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’à chaque moment qu’un journaliste filmera un fonctionnaire de police, de la gendarmerie, un militaire, il y aura un risque qu’il soit interpelé du seul fait qu’il est en train de filmer. Pareil pour un simple manifestant qui fera un live sur Facebook ou tout autre réseau social.
Ce n’est pas que cette loi. Il y a d’autres dispositifs à côté comme le « Schéma national du maintien de l’ordre » qui est en train de créer un distinguo entre « bons » et « mauvais » journalistes, entre ceux qui sont accrédités par le ministère de l’Intérieur et les autres, ceux qui ont une carte professionnelle et les autres. Voilà ce que l’on est en train de voir aujourd’hui. C’est-à-dire une appropriation du journaliste par la sphère publique. Un peu comme l’ORTF. On essaie de contraindre les journalistes à ne pas faire leur travail.
C.B. : Vous venez de le mentionner, la loi est passée au Sénat ; donc, comment maintenant voyez-vous la suite de la mobilisation démocratique pour faire échouer ce projet ?
A.A. : Une fois que la loi est votée au Sénat, en termes de mobilisation il y a surtout une chose importante à faire et qui est en cours de préparation, à savoir une saisine du Conseil Constitutionnel contre cette loi avant qu’elle soit promulguée.
Une saisine qui est en préparation car c’est assez inédit. Il y a des professeurs de droit, il y a des militants, il y a bien évidemment des parlementaires qui vont saisir le Conseil Constitutionnel, qui se sont regroupés pour travailler sur une saisine extrêmement complète, précise, profonde, afin d’essayer d’obtenir du Conseil Constitutionnel qu’il puisse censurer tout ou partie de ce texte.
C.B. : Élargissons un peu le débat. Je viens de terminer la lecture de votre ouvrage « Le coup d’État d’urgence permanent ». Dès le prologue, une phrase m’a marqué : « Depuis cinq ans, la France a vécu plus de temps sous le régime d’exception de l’état d’urgence que sous le régime du droit commun. » Je n’y avais pas réfléchi, c’est effrayant !
A.A. : Quand on y pense de cette manière on se rend compte que sur 5 ans ½ maintenant (le livre a été écrit l’été dernier), on a passé plus de temps en état d’urgence qu’en droit commun. L’état d’urgence suite à la crise terroriste de novembre 2015, puis l’état d’urgence sanitaire créé à la suite de l’apparition de la pandémie en France. Des états d’exception, c’est-à-dire des états qui vont concentrer les pouvoirs, judiciaires et législatifs, entre les mains de l’exécutif et qui vont transformer d’abord notre vie individuelle, la façon de se mouvoir dans l’espace, d’exister, d’exprimer nos libertés, mais également qui vont transformer de manière radicale et profonde l’intégralité de nos institutions.
C.B. : Dans cet ouvrage que j’ai particulièrement apprécié, vous évoquez le fait que les attentats de 2015 et l’épidémie du COVID 19 ont créé, je vous cite « un état de sidération individuel et collectif ». Cela m’a fait penser à la thèse de Naomi Klein dans son ouvrage « La stratégie du choc ». Son livre décrit la méthode de « traitement de choc » de l’économiste Milton Friedman, lequel disait qu’après une crise, les hommes politiques devaient imposer immédiatement des réformes économiques douloureuses avant que les gens aient pu se remettre de la crise. Ainsi, ils l’accepteraient plus facilement. Naomi Klein a nommé cette méthode la « stratégie du choc ». Elle considère qu’après un choc les individus se voient plongés dans un état de choc et redeviennent comme des enfants, enclins à suivre les leaders qui prétendent vouloir les protéger. Est-ce une logique similaire que vous décrivez ?
A.A. : Je ne peux que partager les conclusions de Naomi Klein. Il faut bien faire le distinguo pour ne pas tomber dans le complotisme.
Évidemment il y a eu une crise terroriste d’ampleur le 13 novembre 2015 qui a créé un état de sidération.
Évidemment il y a eu une pandémie qui a commencé en France aux mois de février-mars 2020 et qui a transformé également nos vies.
En revanche le choix du politique a été d’adopter des dispositifs d’exception qui ont comme l’état d’urgence sécuritaire de 2015 et l’état d’urgence sanitaire de 2020 prorogé l’état de sidération dans lequel ces crises nous avaient mis, en tant que population.
Et puis ils ont décidé de les prolonger indéfiniment comme ce fut le cas pour l’état d’urgence sécuritaire qui a été prolongé pendant 2 ans puis intégré dans le droit commun avec la loi SILT.
Comme ce fut le cas et comme cela est toujours le cas avec l’état d’urgence sanitaire.
Il faut bien faire le distinguo entre la situation de crise sécuritaire et sanitaire et le dispositif légal d’exception que sont les états d’urgence et qui ont pour vocation de concentrer tous les pouvoirs et même peut-être de profiter d’un effet d’opportunité de cette fragilité de la population et de cet état de sidération afin d’adopter des dispositifs encore plus liberticides pour réduire toutes les libertés.
Il faut bien comprendre que l’État a pour vocation de gouverner et donc de réduire les libertés qui sont des obstacles à la gouvernance.
C.B. : Je vous cite encore : « Le droit de l’antiterrorisme a progressivement contaminé le droit pénal, qui ne s’est plus contenté de sanctionner des actes, mais aussi des intentions. » N’est-ce pas à rapprocher de la publication des décrets du 2 décembre 2020 modifiant les articles R. 236-1 à R. 236-20 du Code de la Sécurité Intérieure aux fins d’étendre le champ des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes administratives liées à la sécurité publique et au titre de la prévention des atteintes à la sécurité publique ? Ces deux décrets ne consacrent-ils pas un « délit d’opinion, ou d’intention » ?
A.A. : Ce ne sont pas des décrets qui instaurent un délit. C’est la loi qui instaure un délit et non pas les décrets. En revanche ils étendent les possibilités de fichages politiques, religieux, militants, alors que c’était réservé à l’extrême noyau de la sureté nationale. Là on a une extension de la possibilité de fichage.
En revanche vous avez raison, cela rejoint la logique des lois antiterroristes, cela rejoint la logique des états d’urgence dans le sens où ce glissement progressif du judiciaire vers l’administratif a tendance à sanctionner bien avant la commission d’un acte, alors que le droit pénal sanctionne normalement des actes, sanctionner des intentions, des comportements et donc ne plus sanctionner des actes terroristes ou des actes délinquants mais sanctionner peut-être même des actes militants, des actes politiques, des intentions politiques. C’est là que l’on va et c’est exactement le sens de ce décret qui est un décret « outil » pour ficher et essayer d’avoir un mécanisme de surveillance et de quadrillage sur toute la sphère politique et militante afin, éventuellement, à terme de les interpeler ou de restreindre leurs libertés.
C.B. : Vous écrivez : « La stratégie de l’illégalisme est délibérée. Elle a pour objectif de repousser les limites de l’admissible, de banaliser les pratiques illégales afin d’habituer l’opinion publique à leur usage. Surtout, elle est une manière de tester la capacité de résistance des institutions démocratiques ». Pouvez-vous développer votre pensée et donner quelques exemples concrets. Est-ce à dire que nous ne serions déjà plus dans un État de droit ?
A.A. : Chaque jour depuis quelques années on se rend compte que nos libertés sont en train de décroître. On s’en rend compte et on n’a pas de capacité véritable d’action. On n’arrive pas véritablement à se révolter. Bien entendu il y a eu la coordination « loi sécurité globale » avec des manifestations mais globalement l’État l’emporte sur tous ces combats en matière de liberté contre les militants et les associations de Droits de l’Homme. L’une des méthodes utilisées par l’État c’est justement cette stratégie de l’illégalisme. C’est quoi ? C’est, avant même qu’une loi soit passée, l’utilisation de mécanismes illégaux comme les drones qui, avant la loi sécurité globale, ont été mis en œuvre alors même que c’était illégal. Le Conseil d’État l’a rappelé sur saisine de la LDH et de la Quadrature du Net. Il a été obligé de le rappeler deux fois au Préfet Lallement parce qu’il continuait à les utiliser alors même que c’était illégal.
Pareil pour les « nasses » dans les manifestations, c’est-à-dire ces mécanismes qui consistent à entourer les manifestants en violant leur droit à manifester mais également leur liberté, ce qui constitue une infraction pénale. Là aussi on l’utilise alors que c’est illégal.
Les violences policières, l’usage d’arme en visant les têtes, tout ça ce sont des mécanismes d’illégalisme car ce sont des pratiques illégales pour l’État, les autorités, la police, qu’ils savent pertinemment être illégales et pourtant ils les utilisent pour tester l’opinion publique – c’est ce qu’on appelle la fenêtre d’Overton – pour essayer de repousser les limites de l’acceptabilité de quelque chose. Mais également pour tester l’opinion du législateur pour à terme permettre l’adoption de lois comme la loi « sécurité globale ».
C.B. : Vous parlez de la « nasse », « nasse » que nous avons expérimentée ensemble il y a quelques mois d’ailleurs ! Toujours dans votre livre, vous expliquez, cas concrets à l’appui, que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la loi étant peu précise, la police est amenée à l’interpréter sur le terrain et que la fragilité politique du gouvernement amène celui-ci à « lâcher la bride » aux forces de l’ordre pour s’assurer de leur fidélité. Chacun a pu constater que, depuis les manifestations contre la loi travail, n’en déplaise à Monsieur Macron qui refuse d’en entendre parler, les violences policières sont de plus en plus fréquentes et importantes. Sommes-nous là encore dans un État policier ou y allons-nous ?
A.A. : L’Etat policier pas encore. Mais avant il faut bien définir ce qu’est un Etat de droit avant de parler de tout cela.
Un État de droit c’est un État, une démocratie, dans lequel les décrets et règlements c’est-à-dire les actes de l’administration ou du gouvernement découlent d’une habilitation du législateur.
C’est la loi qui décide et c’est le gouvernement qui exécute.
C’est aussi une démocratie dans laquelle on peut faire un recours contre toutes les décisions du gouvernant contre soi. C’est-à-dire que si vous avez une décision individuelle qui vous est défavorable, vous avez le droit d’exercer un recours notamment devant le Tribunal administratif.
Voilà ce qu’est en gros un État de droit.
Il se trouve que pendant l’état d’urgence sanitaire il y a eu une loi « d’état d’urgence sanitaire » et puis il y a eu des décrets. On a interdit par exemple aux personnes d’aller dans la rue sauf quelques exceptions bien précises.
On a dit qu’il fallait, pour justifier ces exceptions (courses, jogging etc..) qu’il fallait justifier d’un document. Et pourtant le ministère de l’Intérieur a fait croire à la population qu’il fallait émettre une attestation précise avec des cases à cocher, avec certains motifs et les policiers ont contrôlé ces attestations avec une grande latitude. La loi ne prévoyait pas très exactement ce qu’il fallait mettre ni comment. En laissant cette latitude aux policiers on a vu quoi ? On a vu des policiers verbaliser voire envoyer des personnes devant un tribunal correctionnel après 3 violations du confinement. Les verbalisations concernaient par exemple des personnes qui avaient rempli l’attestation – non prévue – avec un crayon à papier, ou si l’on faisait des courses ils vérifiaient le chariot de la personne – ce qu’ils n’ont pas le droit de faire – pour voir si c’était bien des achats de première nécessité qui avaient été faits.
Vous voyez qu’au final c’est la police dans la rue qui fait la loi dans la mesure où le législateur leur a donné une très grande latitude, notamment en matière pénale alors que c’est au législateur de faire la loi, ce qui a entraîné un million de contraventions, beaucoup de personnes devant les tribunaux et beaucoup de verbalisations indues.
Ce n’est pas un Etat policier mais on commence, dans ces mécanismes, à s’en rapprocher.
C.B. : Nous arrivons au terme de cette émission. Voulez-vous rajouter quelque chose pour nos auditeurs ?
A.A. : Oui. Je voulais dire que le constat de cet ouvrage « Le coup d’État d’urgence permanent » est probablement pessimiste parce que l’on a une lente dégradation de nos libertés publiques et une érosion de l’État de droit. J’ai un peu le sentiment, comme beaucoup, que la situation politique également se dégrade. En revanche j’ai toujours conscience que l’histoire est longue et que l’on a toujours la possibilité de trouver les moyens de se battre, de militer et de trouver les moyens de contester une politique de dégradation des libertés publiques et c’est vraiment le travail que l’on doit faire de manière collective. Le mot « ensemble » est un mot important pour essayer de protéger notre État de droit et faire en sorte que nos enfants aient la même vie que celle que nous avons eu depuis des décennies.
Notre émission arrive à son terme, il ne me reste plus qu’à remercier Anna Holveck à la réalisation, Catherine Dérérhé à la technique et Claire Poinsignon à la production.
Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.