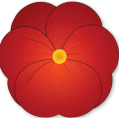La Libre Pensée a le plaisir et l’honneur de diffuser l’émission de l’Union rationaliste sur France-Culture sur la question de la situation de l’Hôpital du 27 juin 2021.
Le script de l’émission a été publié dans Les Cahiers de l’Union rationaliste N°672-673 de mai-Aout 2021
Nous remercions l’Union rationaliste de son autorisation.
*****
Hôpital : crise et expertise
Emmanuelle Huisman-Perrin et Guy Bruit reçoivent le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière.
transcription de l’émission du 27 juin 2021
Emmanuelle Huisman-Perrin : Aujourd’hui à l’antenne de l’Union rationaliste, Guy Bruit et André Grimaldi se retrouvent autour du numéro 217 de Raison Présente : Crise et expertise. Guy Bruit, vous êtes le directeur de Raison Présente, pouvez-vous nous parler de l’importance de ce numéro ?
Guy Bruit : Très brièvement, je voudrais dire que constituer un numéro comme celui-ci sur des problèmes d’actualité est assez exigeant, parce qu’il est difficile pour une revue trimestrielle de traiter à la fois de l’Histoire avec un grand H et de l’actualité. On risque très vite de s’enliser dans l’actualité, de dire n’importe quoi ou ce que tout le monde a déjà dit. Il faut avoir suffisamment de recul pour parler un peu sérieuse- ment des problèmes abordés. Nous avons essayé de jongler avec ces difficultés, ce qui fait qu’il y a un article d’histoire écrit par Fabienne Bock, qui montre comment la notion d’expertise s’est construite de la fin de l’ancien régime à la Grande Guerre. Sur la question de la science, telle qu’elle a pu se pratiquer et se faire dans la crise dite de la Covid, nous avons essayé de regrouper les choses de la façon suivante : deux articles de Jean Jouzel et de Patrice Debré montrent comment la science se construit. Ce qui nous a intéressés, c’est qu’il s’agit d’hommes de terrain, théoriciens certes, mais en même temps hommes de terrain. Nous avons montré aussi quels pouvaient être les problèmes de l’école et en quoi il pouvait y avoir une intrication entre l’école et la science. Alors, pour la science nous avons beaucoup reproché à Monsieur Blanquer de penser que les sciences cognitives permettraient de sauver l’école. Et nous avons donné la parole à Laaldja Mahamdi, qui, elle, connaît très bien ces problèmes : elle est directrice d’une école dans le XIXe arrondissement de Paris [École élémentaire d’application Simon-Bolivar], et elle explique comment diriger une école dans le XIXe, pendant la crise sanitaire ; ça n’a précisément pas été aussi simple que nous le disait notre chef.
E. H.-P. : Et j’ajoute que Philippe Champy s’est également occupé d’analyser ce qu’il en était du rapport d’expertise au sens cognitiviste que le ministre Blanquer utilise fréquemment.
G. B. : Oui, en gros je dirais qu’il montre comment la science peut être dévoyée en fonction d’objectifs politiques et très idéologiques. Et puis le numéro s’appelle crise et expertise. L’expertise ? Le problème de l’expertise et des experts a une place tout à fait centrale. C’est la rai- son pour laquelle le numéro s’ouvre par un excellent article philosophique, écrit par vous Emmanuelle, et qui nous montre comment nous pouvons encore faire notre profit de la lecture de Platon et des Sophistes, ici Protagoras, qui nous aident à nous poser les bons problèmes de la bonne façon. Et puis, il y a un article écrit par Thierry Leterre qui nous parle du problème de la liber- té : qu’est-ce que notre liberté dans une telle situation ? Voilà ce que nous avons essayé de montrer. Il y a un article auquel je n’ai pas fait allusion, parce que c’est celui qui va être l’objet de l’entretien entre le professeur André Grimaldi et Emmanuelle.
E. H.-P. : Oui, merci Guy.
André Grimaldi : Bonjour.
E. H.-P. : Je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié Salpêtrière et vous avez cosigné avec Jean-Paul Vernant, dans ce très beau numéro de Raison Présente, crise et expertise, un article qui me semble non seulement important, mais aussi nécessaire. Vous y produisez une analyse historique de l’hôpital public depuis 1958, puis vous réfléchissez à la façon dont l’épidémie de Covid 19 est arrivée dans un hôpital public à bout de souffle et en crise. Vous analysez les raisons de la déception du personnel hospitalier et des médecins face au Ségur de la santé, et vous faites des propositions pour reconstruire l’hôpital public par la démocratie sanitaire. Voilà le plan de votre article. Ma première question est la suivante : comment l’épidémie de Covid 19 a surgi dans un hôpital public en crise, et quelles ont été les différentes dynamiques vis-à-vis de ces vagues épidémiques successives ?
A. G. : Effectivement, l’hôpital était en crise depuis des années, le système de santé lui-même était en crise : on a eu les crises des EHPAD, les crises de la psychiatrie, les crises de la pédiatrie, crises qui étaient dues, d’une part à une politique d’austérité depuis la crise de 2007- 2008 et à une gestion commerciale. Disons qu’on appliquait l’idée de l’hôpital-entreprise, entreprise commerciale. Donc le dogme était devenu : pas de stock, du flux. Pas de stock, du flux pour les médicaments, des médicaments aussi indispensables que le curare, le midazolam pour endormir les patients. On en manquait, on manquait de tout, on manquait de masques, évidemment ; mais c’était vrai aussi pour les lits d’hôpital : pas de stock, du flux. Et donc l’hôpital s’est trouvé complètement démuni. Ce qui a été finalement le choc, c’est que, face à la première vague, il y a eu une mobilisation des soignants qui ont inversé complètement cette logique ; par nécessité, c’est eux qui ont pris la main.
E. H.-P. : Par rapport aux directeurs d’hôpitaux ?
A. G. : Par rapport aux gestionnaires. Avant, on faisait des soins pour la gestion, pour être en équilibre pour qu’on ne soit pas en défi- cit ; tout d’un coup, ce n’était plus le problème. Les soignants étaient eux-mêmes totalement solidaires, il n’y avait plus de querelles entre disciplines, tout le monde était mobilisé et le pays était mobilisé derrière ses soignants au nom de valeurs qui mobilisaient un pays. Donc le paradoxe était : on était démuni et on retrouvait le sens profond du soin. Ce qui est arrivé dans cette première vague, c’est qu’on a vu directement ce qu’était un service public au service du public.
E. H.-P. : Absolument.
A. G. : Avec des gestionnaires au service des soignants. C’est ce à quoi on aspire, voilà ce qu’on veut. Arrive la deuxième vague. On peut dire là que le choix a plutôt été de maintenir l’économie. On a arbitré entre deux questions : faut-il laisser les musées ouverts ou les grands magasins comme le BHV, le Printemps, etc. On a laissé les grands magasins ouverts et on a fermé les musées. Et puis, avec la logique qu’on a pris de vivre avec le virus, de demi-mesures pénibles, de couvre-feu, de semi-confinements, est arrivée la troisième vague, où là la population était épuisée. En gros, à ce moment- là on a suivi ce qui est acceptable par la population ; et, paradoxalement, les soignants, notamment les médecins, sont devenus ceux qui nous empêchent de vivre normalement. Donc on est retombé dans une dépression profonde qui touche les hôpitaux ; maintenant on a donc l’inverse. Un collègue réanimateur écrit dans le journal Le Monde : « je n’ai jamais vu autant de soignants démotivés », alors qu’on a eu une motivation exceptionnelle à la première vague. Voilà donc la situation dans laquelle on est, et il dit lui- même : « je ne dormais pas pour savoir si j’avais pris les bonnes décisions d’intuber ou pas un patient : que fallait-il faire ? Tout cela n’était pas très codifié, et on avançait à tâtons, au mieux ». Il dit maintenant : « je ne dors plus, parce que je me dis : ’’est-ce que l’hôpital public va survivre à cette crise ?’’ ».
E. H.-P. : Alors, qu’avez-vous pensé du Ségur de la santé ? Est-ce qu’on n’est pas en droit aujourd’hui, comme votre collègue hospitalier, de perdre espoir ?
A. G. : Le Ségur comportait deux volets. Il y avait un volet indispensable et urgent qui était une négociation salariale. Nous étions, avant le Ségur, pour le salaire d’une infirmière par exemple, en vingt-huitième position sur trente-deux pays de l’OCDE. Au bas de l’échelle, de manière tout à fait inadmissible, parce que les coûts salariaux, la masse salariale c’est le principal objet de dépense de l’hôpital public, et dans la politique d’austérité, la première chose que faisait un directeur, c’était de comprimer la masse salariale. Ce qui fait aussi que derrière le « pas d’embauche », il y a des conditions de travail dégradées, donc une qua- lité de soin dégradée. Mais il y a eu une avancée. On ne peut pas dire que huit milliards c’est rien, il y a une avancée qui ne nous met pas encore à la moyenne de l’OCDE, qui devrait être au moins l’objectif de la France, être au moins dans la moyenne de l’OCDE pour le salaire moyen des soignants. Et puis, il y avait un deuxième volet qui était : quelle leçon on en tire ? Quelle place pour l’hôpital public ? Est-ce qu’on ne s’est pas trompé sur l’hôpital-entreprise avec cette gestion, cette tarification à l’activité comme si on était une grande surface qui vend des produits, à l’occasion qui vend des séjours ? Et là, grande déception, parce qu’il y avait eu les discours du président de la République qui avaient laissé un grand espoir : l’État-providence, ce n’est pas une charge, c’est une chance, il faudra vous réinventer. On s’est donc dit : il y a une compréhension, il y a un changement d’orientation. Et, patatras, le premier ministre, Édouard Philippe à l’époque, introduit le Ségur en disant : « le diagnostic était le bon, nous avons fixé le bon cap, il s’agit seulement d’accélérer ». C’est typique, dans la convocation du Ségur, le mot « public » n’est pas écrit une seule fois. Alors tout le monde est déçu, c’est- à-dire que les professionnels de ville disent : « Et nous ? Il faut un Ségur pour la ville ! » ; Les médecins de santé publique disent que la santé publique est un grand sujet : on a vu qu’on avait de grands progrès à faire, et ils disent : « il nous faut un Ségur de la santé publique » ; et l’hôpital est déçu et dit : « il nous faut un deuxième Ségur ». Donc ce Ségur a été une manière d’enterrement de ce qu’avait été la prise de conscience sur le système de santé : ses qualités, qui étaient notamment le traitement des maladies aiguës, les professionnels et la sécurité sociale, et ses grands défauts : le traitement des maladies chroniques et les inégalités sociales. Parce que cette épidémie est une syndémie, c’est la conjonction de trois épidémies : c’est une épidémie virale ; c’est une épidémie de maladies chroniques, de l’obésité et du diabète, 60 % des patients qui font des formes graves sont obèses ou diabétiques ou à ma- ladies cardio-vasculaires ; et c’est une épidémie de la pauvreté. Elle met un effet de loupe sur les défauts de notre système de santé : la prise en charge des maladies chroniques, la prévention, les inégalités sociales, la sécurité sanitaire. Donc voilà la grande déception du Ségur sur ce point..
E. H.-P. : C’est aussi dans ce sens que vous avancez dans cet article très important des propositions décisives qui nécessitent, semble-t-il, une volonté politique forte. Quelles sont vos propositions, André Grimaldi ?
A. G. : Évidemment, on ne peut pas traiter l’hôpital. L’hôpital n’est pas malade en soi, c’est le système de santé qui est malade. Nous avons construit un système de soin au- tour des maladies aiguës, où nous sommes assez performants, parce qu’au fond la chirurgie ambulatoire, c’est un grand progrès : la prise en charge des infarctus du myocarde, c’est un grand progrès ; les greffes d’organes, on n’en parle pas, il n’y a pas de scandale, c’est quand même une organisation des soins qui fonctionne. Par contre nous sommes très mauvais sur tous les terrains de la prévention, sur les maladies chroniques et sur la santé publique, et ça de manière historique. Alors, il faut revenir au fond à ce qu’étaient les valeurs de ceux qui ont créé la sécurité sociale en 1945. C’était l’idée d’un bien commun, qui ne doit pas être privatisé, qui ne doit pas être étatisé, et l’évolution s’est faite au contraire dans une étatisation de la gestion et une privatisation de la distribution des soins. Donc il serait assez logique de dire : « reprenons ce qui a été en gros le compromis historique de 45 », et ce qu’il faut maintenir, c’est un truc incroyable, parce que si nos professionnels de santé sont moins bien payés que la moyenne de l’OCDE, par contre en frais de gestion, nous sommes très au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Nous dépensons sept mil- liards et demi de frais de gestion de ce qu’on appelle les assurances complémentaires, mutuelles et autres, sept milliards et trois mil- lions pour la sécu, alors la sécu rem- bourse 78 % des soins et dépense moins en frais de gestion que les complémentaires qui remboursent 13 % ; et puis on a deux milliards et demi pour les agences de l’État. Donc on a dix-huit milliards de frais de gestion ! On devrait donc commencer par se poser cette question : on a un système qui est à la fois déficient et suradministré, et puis on a une médecine très prescriptive. En plus on a un vrai problème, c’est- à-dire quand même un problème de démocratie. Tout ce système a évolué vers une logique à la fois de gestion étatique, bureaucratique et de business commercial, dans le dos de la population. Jamais la population n’a été interrogée d’une manière ou d’une autre pour savoir si on dépense assez ou pas pour la santé, quels sont les gaspillages et qu’est-ce qu’on pourrait faire. Enfin il n’y a pas de débat réel sur ce sujet, et le risque d’ailleurs c’est que ce débat soit même escamoté lors des échéances qui viennent. Alors évidemment, il faudrait qu’il y ait l’idée d’une cogestion. Personne n’a envie de défendre un système public bureaucratisé, dysfonctionnel, où la qualité des soins se dégrade. Tout le monde dit qu’il faut refonder un service public. Alors est-ce qu’on doit aller vers un service public ou du privé non lucratif ? Avec les crises qui s’annoncent, je crois qu’il faut une cogestion, une cogestion avec l’État, décentralisée. Il faut que les collectivités territoriales, on l’a vu dans la crise, jouent un rôle ; il faut que les associations de patients jouent un rôle ; des conférences citoyennes peuvent jouer un rôle. Les gens sont attachés à ce bien supérieur qu’est la santé ; encore faut-il donner les moyens démocratiques à la société de s’exprimer sur ce sujet.
E. H.-P. : Qui peut porter un tel projet ? Politiquement ?
A. G. : Comme je suis professeur dans la santé, je ne sais pas qui. Je frappe à toutes les portes, en gros pour réactiver cet esprit de 45. Ce qui me paraît le plus urgent actuellement, c’est d’ouvrir des espaces démocratiques. Est-ce qu’on peut avoir un référendum sur ce qu’on dépense, trop ou pas pour la santé ? Est-ce que des conférences citoyennes peuvent exister ? Au niveau local, au niveau régional ? Le budget est voté chaque année à l’automne par des députés qui lèvent la main, en suivant ce que dit l’exécutif. En 2019, le parlement vote une augmentation du budget de 2,1 %. Il y a la crise des hôpitaux. Le Premier ministre, Édouard Philippe, et la ministre de l’époque, Agnès Buzyn, décident de l’augmenter à 2,4 %. Les députés, qui avaient déjà voté, lèvent à nouveau la main pour voter 2,4. On leur aurait dit 3, ils auraient dit 3 ! On a à la fois une démocratie représentative qui est indispensable, parce que c’est le socle de la démocratie, mais où est la démocratie sanitaire ? Où est la démocratie citoyenne ? Donc tout ça est à repenser, si on veut une société nouvelle, moderne et pas seulement s’en remettre à… au Président le plus intelligent du monde.
E. H.-P. : C’est sur ces mots que nous allons clore cette émission, je redis le titre de votre article, écrit avec Jean-Paul Vernant : Reconstruire l’hôpital public par la démocratie sanitaire. André Grimaldi, je vous remercie.
A. G. : Merci à vous.
E. H.-P. : Vous pouvez vous procurer le numéro 217 de Raison Présente sur Crise et expertise en le commandant sur le site de l’Union Rationaliste, comme d’ailleurs le numéro 216, dans lequel Frédéric Piéru a écrit un bel article intitulé Quelques considérations sur l’hôpital de flux. Je remercie Peire Legras qui a rendu possible cette émission.