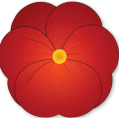Un principe multiséculaire
L’irresponsabilité pénale des personnes atteintes de démence au moment où elles commettent un crime ou un délit constitue un marqueur essentiel de civilisation. Déjà, l’empereur Marc Aurèle (121-180) gracie un homme ayant tué sa mère au motif que « le furieux se trouve suffisamment puni en raison de son état de santé. » Selon le Code de Justinien de 529 « Le crime n’est engagé que si la volonté du coupable survient. » L’article 64 du Code pénal de 1810 prévoit, quant à lui, qu’« Il n’y a pas de crime ni de délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. »
En des termes modernisés, les articles 122-1 et 122-2 du Code pénal actuellement en vigueur reprennent le même principe : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » ; « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. » De surcroît, l’article 122-1 distingue l’abolition du discernement de sa simple altération : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »
Une affaire classique instrumentalisée à tort
Dans une affaire de meurtre, l’application de ces dispositions donne lieu, sans succès, à contestation de la part des parties civiles devant la Cour de cassation qui se borne à rappeler le droit. Pourtant, son arrêt du 14 avril 20211 suscite une polémique enflammée, dans un climat déjà électrisé par tous ceux qui dénoncent, afin de semer la peur dans la population, un déchaînement de violence dans le pays, une mise en danger systématique des policiers et un prétendu laxisme généralisé de la justice.
Le 4 avril 2017, un homme, gros consommateur de stupéfiants, frappe et blesse grièvement une voisine d’origine juive avec un téléphone portable et la tue en la défenestrant aux cris de « Allah Akbar ! Que Dieu me soit témoin ! ». Six des sept psychiatres désignés pour mener les trois expertises des 4 septembre 2017, 24 mai et 7 juin 2018, et 24 septembre 2018, tout en établissant un lien entre l’usage de stupéfiants et l’état mental de l’auteur lors de son acte, concluent à l’abolition du discernement du meurtrier au moment des faits en raison de la bouffée délirante qui l’a envahi. Le 14 avril 2017, durant son séjour en hôpital psychiatrique, le parquet ouvre une information judiciaire et le juge d’Instruction, le 10 juillet suivant, le met en examen des chefs d’homicide volontaire et de séquestration.
Au terme de l’information, le 17 juin 2019, le parquet requiert définitivement le renvoi du meurtrier devant la cour d’assises tandis que les deux juges d’Instruction, par ordonnance du 12 juillet suivant, transmettent la procédure à la chambre de l’Instruction, d’une part, en écartant la qualification d’homicide commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée, d’autre part, en présumant l’irresponsabilité pénale du mis en cause.
Les parties civiles et le Parquet font appel de cette ordonnance, sans succès : le 19 décembre 2019, la chambre de l’Instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle les charges retenues contre le meurtrier, sans se prononcer clairement sur le caractère présumé antisémite de l’acte, et confirme son irresponsabilité pénale.
La Cour de cassation au centre d’une polémique inquiétante
Saisie d’un pourvoi formé par les parties civiles, la Cour de cassation doit répondre à deux questions ayant trait, l’une à la procédure, l’autre, à l’effet juridique d’éléments extérieurs à la cause directe de l’irresponsabilité pénale : peut-on interjeter appel d’une ordonnance du juge d’Instruction rendue en cette matière ? Une circonstance susceptible d’entraîner l’abolition du discernement doit-elle être prise en compte pour atténuer l’irresponsabilité ?
L’article 706-120 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction, lorsqu’il la constate au terme de son information « […] rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. » Toutefois, quand une partie civile ou le Parquet le demande ou s’il entend y procéder d’office, il transmet par ordonnance la procédure à la Chambre de l’Instruction. Compte tenu de cette possibilité offerte à la partie civile et au Parquet, voire au juge d’Instruction lui-même, en toute logique son ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel. C’est ce que juge la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 2021 : « Pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l’ordonnance de transmission de pièces, l’arrêt attaqué relève qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l’article 706-120 du même code, puisse faire l’objet d’un appel des parties civiles. »
L’article 122-1 du Code pénal se borne à exempter de toute responsabilité pénale la personne dont le discernement est aboli au moment de la commission du délit ou du crime. Peu importe qu’une circonstance extérieure, le cas échéant imputable à l’auteur de faits, y contribue. C’est ce que rappelle la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence constante : « […] les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement. »
*
Alors d’où vient cet emballement médiatique, nourri par une surenchère sécuritaire et des atteintes incessantes contre les libertés individuelles ou collectives (décrets du 2 décembre 2020 sur le fichage, loi de Sécurité globale, projet de loi renforçant le respect des principes de la République, nouveau projet de loi anti-terroriste) ? Il résulte de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental : ce texte impose au juge d’instruction de rendre « […] une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. » Il s’agit en réalité, de la construction d’un monstre juridique.
Après le drame de l’assassinat à Pau de deux infirmières par un malade mental, le Président de la République alors en fonction souhaite offrir aux victimes la possibilité d’avoir un ersatz de procès devant la Chambre de l’Instruction. En réalité, il crée véritable une monstruosité juridique : lorsque la personne poursuivie est pénalement irresponsable aux yeux de la Chambre de l’Instruction, pour autant, si les charges retenues contre elles sont suffisantes, celle-ci la déclare en même temps coupable : coupable, mais irresponsable. Voilà ce qui arrive quand on légifère sous le coup de l’émotion. Et on nous propose de recommencer !
La Fédération nationale de la Libre Pensée considère que les conditions actuelles de détermination de l’irresponsabilité pénale des personnes dont le discernement est aboli lorsqu’elles commettent un délit ou un crime doivent être maintenues en l’état, d’autant qu’environ 11 000 affaires sont concernées chaque année. Par ailleurs, elle demande l’abrogation de la loi du 25 février 2008 qui entend concilier l’inconciliable : reconnaissance de culpabilité et irresponsabilité pénale. L’affaire Sarah Halimi démontre que ce texte peut provoquer une profonde frustration chez les parties civiles, alors qu’il est censé apaiser leurs souffrances.
Paris, le 1er mai 2021
Cass. Crim., 14 avril 2021, n° 20-80135. ↩